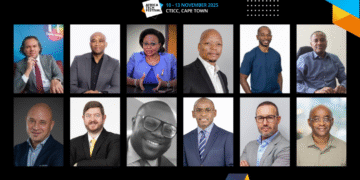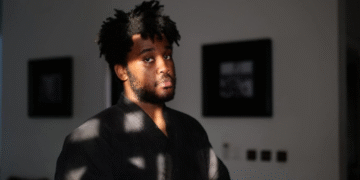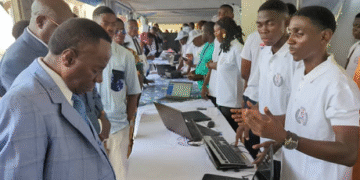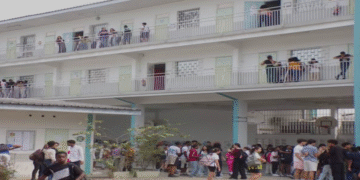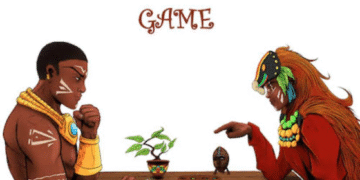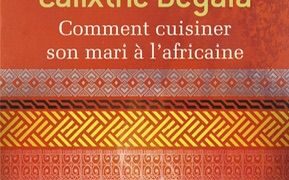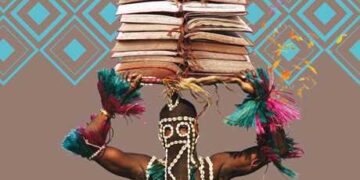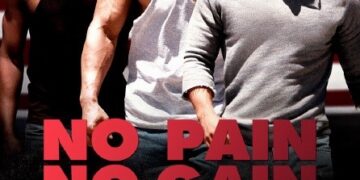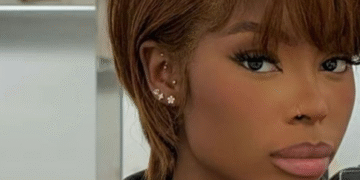Dans l’imaginaire collectif, une union sans enfant renvoie spontanément à une incapacité féminine. Bien qu’elle soit erronée, cette croyance nourrit la stigmatisation de la femme et fragilise son couple.
Dans la petite cour d’une maison du quartier Ekounou, à Yaoundé, Clarisse, 29 ans, baisse les yeux dès qu’elle évoque son mariage. Depuis cinq ans, elle partage la vie de son mari, mais aucun enfant n’est venu combler leur foyer. « Pour ma famille et celle de mon mari, c’est moi la coupable », souffle-t-elle. Sa belle-mère ne cache plus son mépris, ses tantes l’exhortent à « aller se soigner » puisqu’elles, elles ont toutes accouché.
Quant à son mari, il répète sans relâche qu’« une femme, surtout jeune, qui n’enfante pas n’est pas différente d’un homme ». Pourtant, Clarisse a multiplié les examens médicaux : tous affirment qu’elle ne souffre d’aucun problème. Son mari, lui, refuse catégoriquement de se faire consulter. Une attitude qui illustre un tabou persistant: dans de nombreuses familles africaines, l’absence d’enfant est automatiquement mise sur le compte de la femme.
« C’est toujours plus facile d’accuser la femme, comme si un enfant se faisait seul », lâche Emmanuelle, 32 ans, mère de deux enfants. « En Afrique, on veut trop protéger la virilité masculine. Tout ce qui est mauvais, c’est la femme qui le porte », ajoute Herton, 33 ans. Pourtant, les chiffres contredisent ces croyances.
Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), l’infertilité touche environ un couple sur six dans le monde, et les causes sont équitablement réparties entre les deux sexes. Mais dans bien des foyers, l’homme préfère se réfugier derrière le silence et accuser sa partenaire plutôt que d’affronter l’éventualité de sa propre stérilité. Face aux pressions familiales et sociales, certaines femmes s’engagent dans des parcours coûteux et douloureux: traitements traditionnels, décoctions, marabouts, rituels.
Clarisse en a fait l’amère expérience. « Je suis croyante et je prie chaque matin, mais j’ai fini par me dire que Dieu me punissait peut-être pour un mal que j’avais fait. Ma maman n’est plus, ce sont mes tantes qui me guident. L’une d’elles m’a assuré qu’on m’avait sûrement fait quelque chose au village et m’a orientée vers un spécialiste. Je n’ai pas hésité. » Le verdict est sans appel: « Tout mon salaire, toutes mes économies y sont passées. Plus d’un an de traitement… pour rien », raconte-t-elle, le visage fermé.
À la question de savoir pourquoi son mari de se faire consulter, Clarisse répond : « Je crois que c’est évident. Au fond de moi, je sais qu’il a un problème. J’espère juste qu’un jour il finira par l’avouer. Parce que je suis fatiguée… fatiguée des mots durs, des regards accusateurs, des remarques blessantes. »
Pourtant, la médecine propose des solutions : traitements hormonaux, interventions chirurgicales, procréation médicalement assistée (PMA) avec fécondation in vitro ou insémination artificielle. Mais tant que la parole masculine restera enfermée dans le silence et la fierté, ce sont les femmes qui continueront de porter seules le poids de l’infertilité conjugale.