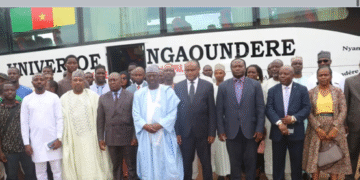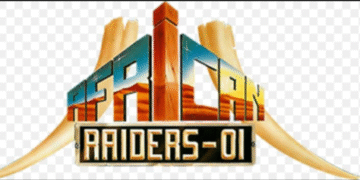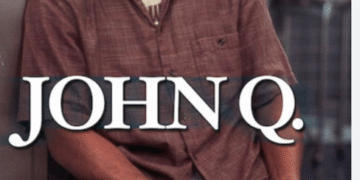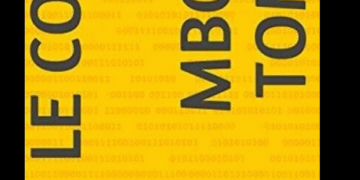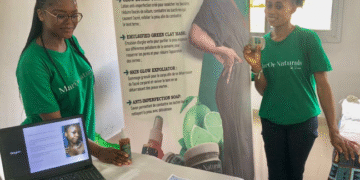À Yaoundé, faire un stage est un passage obligé pour les étudiants et jeunes diplômés. Mais sans rémunération ni aide des parents, beaucoup doivent jongler entre débrouille, petits boulots et sacrifices pour tenir. Entre frustration et espoir d’embauche, ils racontent leur galère.
Pour Serge, étudiant en gestion dans un institut de la place, l’expérience est un double défi : « Je fais un stage dans une agence depuis 2 mois et demi déjà. On m’explique que c’est formateur, mais je dois payer mes transports et mes repas tous les jours. Ce n’est pas toujours évident. Parfois, je me demande si je suis obligé d’acquérir l’expérience là ». Comme lui, de nombreux étudiants passent par des journées à rallonge, combinant stage et activités rémunérées quand elles existent.
Amina, en année de BTS en marketing, raconte : «Je donnais des cours de soutien à des lycéens le week-end pour payer mon transport. Sans ça, je n’aurais pas tenu mes trois mois de stage. Le stage est essentiel pour mon CV, mais je me sens souvent exploitée. » La frustration se mêle à l’espoir d’embauche. Certains y voient un passage obligé vers l’emploi : « C’est vrai que ça forge, mais parfois on a l’impression de travailler gratuitement pour que d’autres profitent de nous », confie Georges, futur ingénieur.
Certaines entreprises réagissent et s’assurent de verser au moins une indemnité de transport. Mais pour Serge, cela reste insuffisant : « On ne demande pas un salaire, juste de quoi survivre pendant qu’on apprend ».
En interne, le sujet divise aussi : certains employeurs défendent ces stages comme nécessaires pour l’apprentissage pratique, tandis que d’autres reconnaissent la précarité qu’ils génèrent. Pour les étudiants, la question est simple : le stage non rémunéré reste un rite de passage, mais à quel prix ?