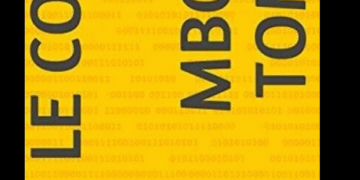Sur la toile, la morale fait du bruit, mais les comportements racontent autre chose.
Sur TikTok, la trend autour de la chanson « Comportement » d’Aya Nakamura fait un carton. Des hommes camerounais, souvent les premiers à afficher leur virilité ou à se dire ouvertement homophobes, se filment en train d’imiter les gestes de la chanteuse : hanches cassées, mimiques séductrices, main dans les cheveux. Une attitude volontairement « féminine », qui contraste avec leur discours public.
Le paradoxe est frappant : ces mêmes voix qui dénoncent « l’influence néfaste » de certains contenus sont celles qui les partagent le plus. Sur les réseaux, les jugements moraux circulent plus vite que les réflexions. On critique les clips jugés « trop sexuels », on dénonce les chanteuses « trop libres », mais on utilise leurs morceaux pour alimenter son image ou gagner des vues.
On s’insurge contre les séries ou plateformes « trop LGBT », mais on enchaîne les épisodes en privé, sans en parler publiquement. Les réseaux sont devenus un espace de désir et de dissimulation : on joue un rôle, on performe la morale, tout en s’autorisant en coulisse ce qu’on prétend rejeter. Pour les jeunes Camerounais, ce double jeu traduit une forme d’adaptation.
Entre les attentes religieuses, familiales et les influences globales, chacun apprend à équilibrer son image : être dans le mouvement sans paraître « déraciné ». « Les gens aiment critiquer pour exister », sourit Chanelle, 23 ans, étudiante. « Mais si tu ouvres leurs téléphones, tu verras les mêmes vidéos qu’ils disent détester. »
Ce paradoxe dit beaucoup d’une génération connectée, partagée entre la morale collective et la liberté individuelle. Et si, finalement, les réseaux sociaux n’étaient que le miroir exact de nos contradictions ?