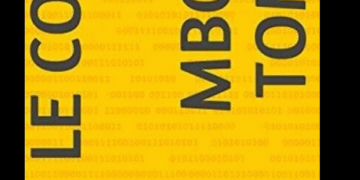Il fut un temps, pas si lointain, où les cours d’école résonnaient du clapotis de l’eau et du frottement des mains. C’était l’époque où le lavage des mains n’était pas une option, mais une leçon. Dans les cours d’école, entre deux dictées et un exercice de mathématiques, les élèves participaient à de véritables séances de sensibilisation à l’hygiène. Les enseignants, eux, devenaient les premiers ambassadeurs de ce geste simple, mais vital.
Ces fameux seaux bleus, installés à l’entrée des salles de classe, étaient plus que des outils de prévention contre le Covid-19 : ils étaient devenus des symboles. Symboles d’un système éducatif temporairement réconcilié avec la santé publique. Symboles d’un État qui, sous la pression sanitaire, se souvenait enfin que l’école est aussi un espace de construction de citoyens responsables. Mais aujourd’hui, alors que la pandémie semble loin derrière nous, ces seaux ont disparu. Et avec eux, l’habitude.
La pédagogie de l’hygiène s’est éteinte, aussi rapidement qu’elle était née. Plus de lavage des mains collectif. Plus de savon aligné à la récréation. Les élèves retombent dans l’indifférence, et parfois, dans l’insalubrité. Ce retour à l’oubli est préoccupant. Il montre à quel point certaines bonnes pratiques ne sont encouragées que sous la contrainte. Pourtant, le lavage des mains reste un rempart contre tant de maladies : choléra, grippe, infections intestinales… L’école aurait pu, aurait dû, pérenniser cet enseignement, en faire un rituel quotidien. Car inculquer la propreté, c’est aussi former à la citoyenneté.
À l’occasion de la Journée internationale du lavage des mains, il est temps de se poser la vraie question : avons-nous raté une belle occasion de construire une génération plus consciente des enjeux sanitaires ? Les seaux bleus ne sont peut-être plus là, mais les leçons qu’ils véhiculaient doivent rester. L’éducation à la propreté ne devrait jamais dépendre d’une crise, mais s’inscrire dans la durée.