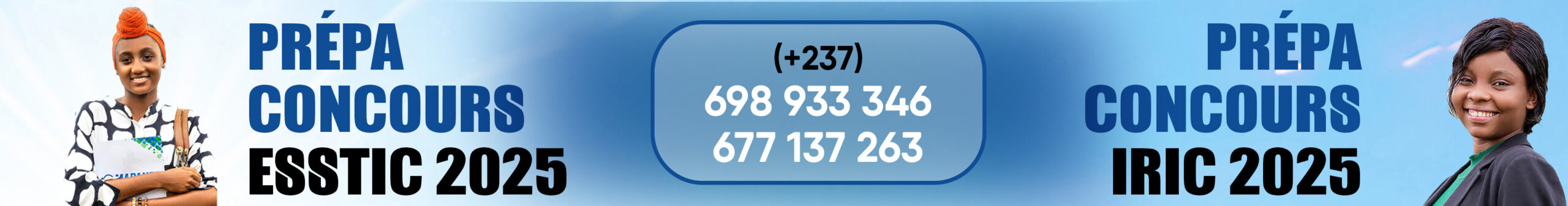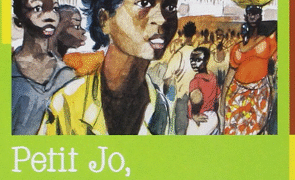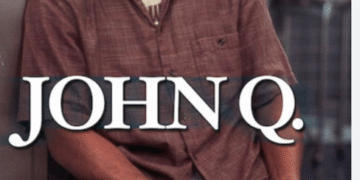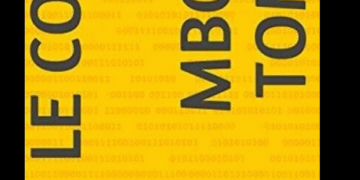Souvent formés sur le tas, ces artisans de la débrouille entretiennent la mobilité urbaine au prix de conditions de travail précaires, d’une insécurité constante et d’une reconnaissance encore limitée.
À quelques mètres du Rond-point « Cami Toyota » à Yaoundé, Étienne, 27 ans, fait des manipulations sur une moto. Il n’a ni blouse, ni équipement sophistiqué. Juste une boîte à outils usée, de l’huile sur les mains et beaucoup d’ingéniosité. « J’ai appris la mécanique avec mon oncle. Je n’ai jamais été dans une école.
Mais je répare tout ce qui a un moteur », dit-il avec assurance. Comme lui, des centaines de jeunes Camerounais ont investi les trottoirs pour exercer la mécanique sans formation formelle. Ici, pas de factures officielles, pas de registre de commerce. Le bouche-à-oreille reste leur meilleure publicité. Les clients viennent pour des services rapides et moins chers que dans les garages agréés. « À cause du coût de la vie, je préfère réparer ici.
Il est rapide et il me connaît », confie un conducteur de moto. Mais ce mode d’exercice pose de nombreux défis. Les conditions de travail sont rudimentaires, les risques d’accidents élevés, et l’instabilité financière constante. « Il y a des jours où je gagne 10 000 F, d’autres rien du tout », explique Jules, mécanicien de fortune depuis 5 ans.
Pourtant, malgré les difficultés, ce métier reste un refuge économique pour des jeunes sans diplôme ou sans emploi. En l’absence d’un encadrement formel, ces artisans de la rue continuent de bricoler leur avenir à coups de clés et de courage, espérant qu’un jour, leur savoir-faire soit pleinement reconnu et soutenu.