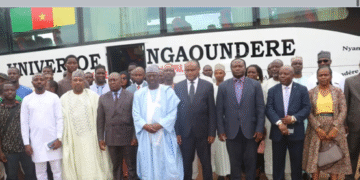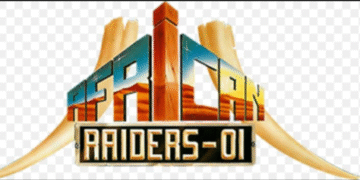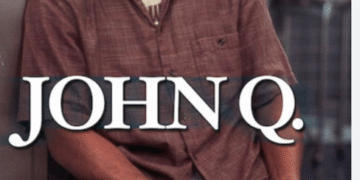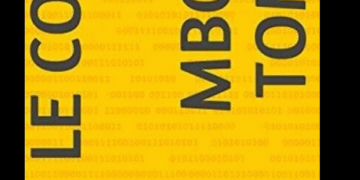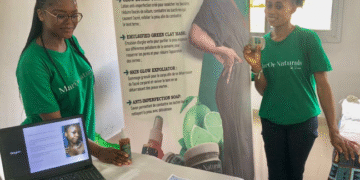Dans de nombreuses familles, atteindre la vingtaine marque le début d’un nouveau type de stress. Qu’on soit encore aux études, en recherche d’emploi ou en train de poser les bases de son avenir, l’entourage semble avoir d’autres priorités entre mariage et procréation.
À 23 ans, Sandra Egbe, étudiante en master à l’Iric, se heurte à cette question presque chaque fois qu’elle rend visite à ses tantes. « Elles me disent que mes camarades ont déjà deux enfants. Pour elles, faire un master, c’est perdre son temps. » Dans certaines familles, surtout dans les zones rurales, une femme non mariée à 25 ans est vue comme trop exigeante ou carrément suspecte. Pire si elle n’a pas encore d’enfant, on évoque la stérilité.
Du côté des hommes, la pression n’est pas moindre. Mais elle prend souvent une autre forme. On attend d’eux qu’ils soient financièrement stables, qu’ils aient un toit et soient capables d’assumer une femme. À 29 ans, Wilfried Zang, comptable avoue : « Mon père m’a dit que je devrais arrêter de perdre du temps avec mes projets et penser à fonder une famille. Mais je construis mon entreprise. Est-ce que ce n’est pas aussi important ? »
La société semble ne laisser que peu de place au choix personnel. Dans un pays où les repères sociaux traditionnels restent puissants, le mariage reste un symbole de réussite. Peu importe que certains couples se séparent à peine quelques mois après leur union. L’essentiel est d’avoir fait comme tout le monde. Les réseaux sociaux contribuent aussi à accentuer cette pression. Photos de mariages grandioses, annonces de grossesses, baptêmes. Tout semble suggérer que la vie ne commence vraiment qu’une fois marié(e) et parent.
« Ce que les gens ne voient pas, ce sont les pleurs derrière les rideaux, les frustrations, et parfois les violences », ajoute Sandra Egbe. Face à cela, une partie de la jeunesse choisit de résister. Des jeunes femmes repoussent l’échéance pour privilégier leur indépendance financière ou leur épanouissement personnel. Des hommes préfèrent stabiliser leurs projets avant de s’engager.
Mais ce choix courageux ne se fait pas sans coût émotionnel : reproches, jugements, rumeurs ou même rejet. Selon la sociologue Marie Monayaho, « ces pressions sont le reflet d’une société en mutation, où l’ancienne génération a du mal à comprendre les priorités de la nouvelle. Le défi est de créer un dialogue intergénérationnel pour permettre à chacun de construire son chemin sans culpabilité ».
Le mariage n’est pas une mauvaise chose en soi. Mais il ne devrait pas être une injonction. Derrière chaque jeune qui traîne à se marier, il y a parfois un rêve, un combat, une ambition. Et peut-être qu’en laissant à chacun le temps de se construire, on bâtira aussi des familles plus solides, choisies, et non subies.