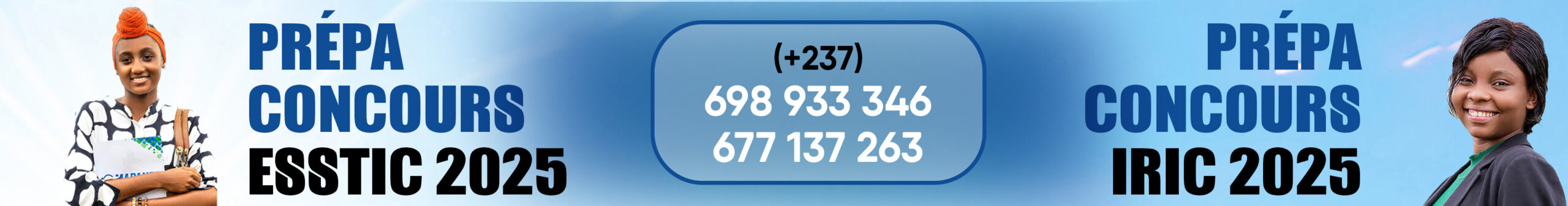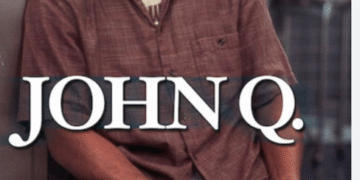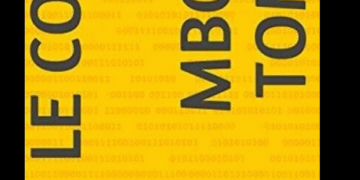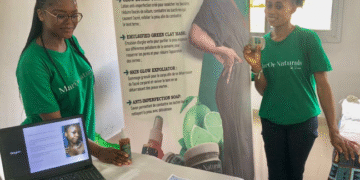Il y a quelque chose de tragique dans le regard d’un jeune diplômé qui, après cinq ou six années d’études, se rend compte qu’il a tout oublié. Pas parce qu’il est paresseux, ni incapable, mais simplement parce qu’il n’a jamais eu l’occasion de pratiquer ce qu’il a appris. La mémoire, comme toute autre faculté, s’use quand elle n’est pas sollicitée. Et au Cameroun, l’inactivité professionnelle vide les têtes bien faites de leur contenu.
Combien sont-ils, ces licenciés en biologie qui n’ont jamais vu un laboratoire depuis la soutenance ? Ces ingénieurs en herbe qui n’ont jamais manipulé un tournevis ? Ces communicants en puissance qui n’ont jamais rédigé une note de service ou animé une campagne ? À quoi sert une formation si elle ne rencontre jamais le terrain ? À quoi bon apprendre si l’emploi reste une illusion lointaine ? Le pire, c’est que l’oubli ne se fait pas que dans la tête. Il s’installe dans le moral. Il ronge l’estime de soi.
Ce que l’université a construit pendant des années, le chômage le déconstruit lentement, jusqu’à ce que le diplômé doute de tout, même de sa valeur. C’est là que naît le fatalisme, le repli, ou pire, l’abandon. Former sans intégrer, c’est gaspiller des intelligences. C’est produire du papier au lieu de produire des compétences. Il est temps de lier formation et employabilité, pas seulement dans les discours, mais dans les faits. Sinon, nos universités continueront de fabriquer des diplômés amnésiques.