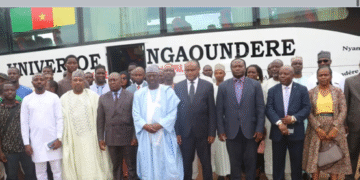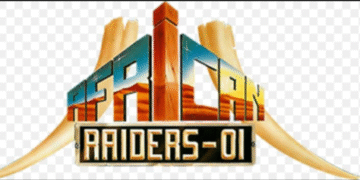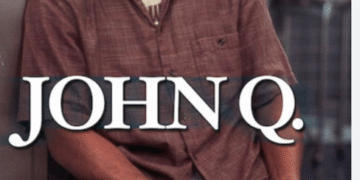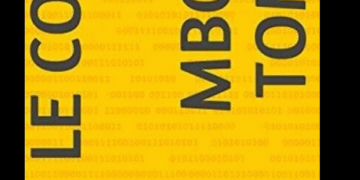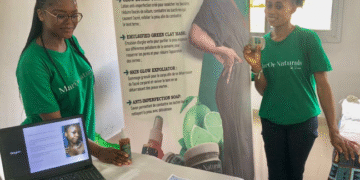Parfois considéré comme une fierté familiale, être étudiant à 16 ans peut aussi être un saut brutal dans un monde d’adultes où la naïveté n’a pas sa place. À cet âge où l’on peine encore à comprendre ses propres émotions, voilà que certains jeunes se retrouvent projetés dans les amphithéâtres d’universités bondées, livrés à eux-mêmes, exposés aux tentations, à la pression sociale et à des responsabilités qu’ils n’ont pas toujours les outils pour affronter.
L’université n’est pas le prolongement encadré du lycée. C’est un espace de liberté mais aussi d’épreuves. Loin des parents, des conseils quotidiens, des heures de rentrée obligatoires et de la surveillance, les plus jeunes peuvent vite se retrouver submergés. Mal encadrés, certains se perdent : échec académique, mauvaises fréquentations, dépendances, grossesses précoces, manipulations diverses. Ce débat ne remet pas en question l’intelligence ou les capacités des élèves précoces. Il interroge plutôt notre système éducatif, qui privilégie parfois la vitesse à la maturité.
Doit-on vraiment applaudir le fait qu’un enfant soit dans le supérieur avant même d’avoir atteint l’âge légal pour travailler ou signer un contrat ? Être prêt intellectuellement ne signifie pas être prêt émotionnellement. Il ne s’agit pas de freiner les talents, mais de mieux les accompagner. Peut-être faut-il penser à des dispositifs spécifiques pour ces jeunes, entre mentorat, encadrement psychologique et sensibilisation à la vie universitaire. Car si l’intelligence peut ouvrir les portes, la maturité est ce qui permet d’y rester.